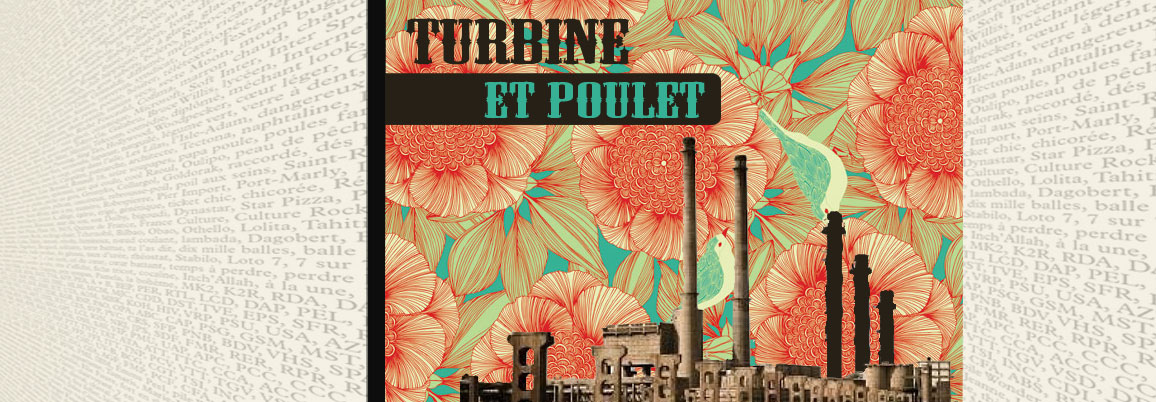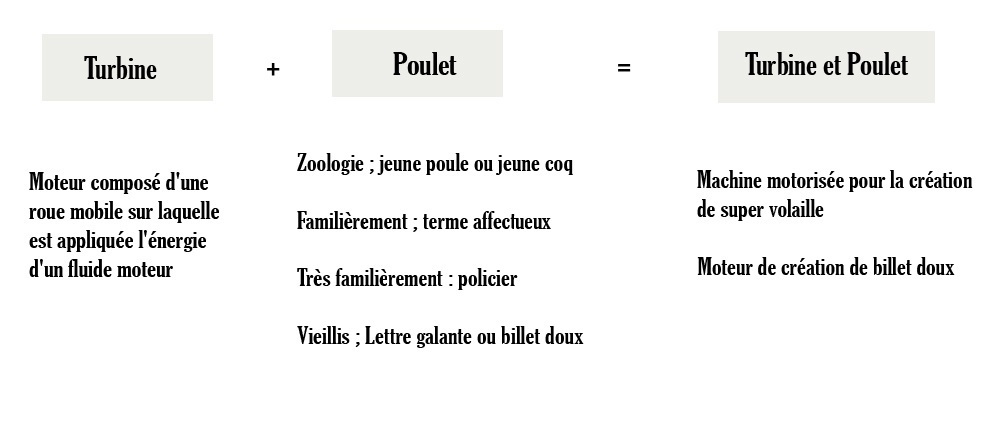Tu m’as trainé dans les rues de Marseille. Je riais fort, je
titubais. Mes chevilles se tordaient sur mes talons trop usés, je me sentais bruler
d’ivresse au bout de ton bras. Je riais dans le caniveau. On à fermé le bar, puis le deuxième. J’ai offert
la rose qu'on m'a offert à la propriétaire, l’ancienne prostitué de Noailles. Une de ces femmes
qui ont des rides qui racontent la nuit, l’alcool et l’odeur des inconnus. Des
rides qui racontent comme elles sont belles, comme elles sont les femmes du
monde, les femmes des trottoirs.
On a finit dans un troquet, un de ces bars qui ne ferment
jamais. Un de ces lieux qui n’existe pas pour la plupart des gens sains. Il y
avait toi, moi et le monde qui n’existe pas. Les hommes qui mangent des
boulettes à la viande entre deux passes, les mafieux, les maquereaux, les
serveuses usées par les piliers. Il y avait toi, qui me regarde rire, qui sais
que je suis bien sur mon tabouret de bar à partager mes luckys avec la serveuse.
Toi tu le trouves pourri ce troquet, tu détestes les piliers qui t’emmerdent à
te demander si tu es algérien ou portugais. Tu détestes le barman qui te sert
ton pastis en souriant comme le soleil. Tu détestes le proprio, le Russe, qui
force ton regard noir pour que tu te rappelles les règles du lieu. Tu détestes
le troquet qui sent la boulette et les fins de passes mais c’est ce qui
ressemble le plus à ton chez toi. C’est ici que tu veux être. Là, au comptoir,
à finir ton verre pour commander « la même », à fumer et à bouffer des olives dégeulasses.
Pour une fois je suis là. Tu n’amène jamais personne ici. Tu
ne veux pas t’occuper de moi mais de temps en temps tu jettes un œil. Tu me
vois rire avec la serveuse, ça te rassure. La nuit défile, les gens moins. Tout
est lent, tristement paisible ici. On à le temps de voir les heures s’échapper.
Je finis par t’agripper la cuisse, j’aime beaucoup ta maison
mais il est 6h15, Marseille se réveille et moi je veux dormir.
Tu écrases ta cigarette sur le comptoir en fixant le Russe.
La serveuse m’embrasse les joues amoureusement. Elle me dit au revoir avec insistance
et j’ai l’impression qu’elle me crie de fuir, loin, loin d’ici, du troquet, de
Marseille. Ses yeux, ses cernes, ses balafres crient la douleur des années de
comptoir, la douleur des nuits et la misère de Marseille. Elle aurait voulu
partir elle, loin des boulettes.
Elle garde un œil sur le bar, sur les hommes seuls et muets
du comptoir. Le patron la surveille, elle le sait, elle évite ses yeux. Elle m’ouvre
la porte. Dehors je t’attrape la main, je te veux encore un peu près de moi. On
marchera alors le plus lentement du monde en se moquant des gens plus saouls
que nous. On regardera les étudiants qui titubent sur le port, les vieux sur
les bancs, les plus pauvres encore dans le caniveau. On marchera le plus
lentement du monde parce qu’on sait qu’on ne rentre nulle part. Cela fait
longtemps que toi et moi nous avons plus de chez nous. Le seul chez nous c’est
le troquet du bas de Marseille qui sent
la boulette et qui sert des olives desséchées dans des verres de pastis.
C’est tout.
On ne rentrera nulle part et demain on s’oubliera. J’écrirai
quelque chose sur toi pour que nos nuits me paraissent exister quelque part.
Pour exister au troquet d’en bas.